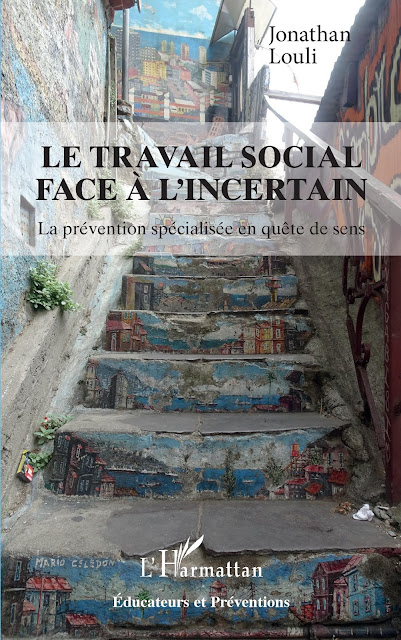La prévention spécialisée est toujours traversée par une instabilité de la place et du statut que lui confèrent les politiciens et les agents de l'Etat. Ceux-ci rêvent parfois d'en faire un service d'insertion ou d'animation, parfois un adjoint aux politiques sécuritaires et de lutte contre la "radicalisation", parfois une "politique publique à part entière", institutionnalisée et contrôlée.
Dans le débat d'idées à propos des raisons d'être et de la philosophie de la prévention spécialisée, nombreux sont les acteurs de terrain à prendre position contre un "réformisme" qui risquerait de mettre sens dessus dessous le sens et les enjeux de la prévention spécialisée.
Notre compagnon de route
Jonathan Louli est depuis longtemps engagé dans ces débats, en faveur d'un plus grand pouvoir accordé aux premières personnes concernées dans les décisions qui les touchent : les travailleuses et travailleurs sociaux de terrain et les habitants avec lesquels ils travaillent.
Il tente de démontrer l'importance de ces revendications dans un livre qu'il vient de publier, intitulé
Le travail social face à l'incertain. La prévention spécialisée en quête de sens, que nous vous invitons à découvrir sur son blog, les
Pages Rouges et Noires.
Ce livre est tiré de longues recherches sociologiques sur le sens que des éducateurs et éducatrices en prévention spécialisée attribuent à leur métier, ainsi que de plusieurs années de militantisme et d'activité comme éducateur de rue en Seine Saint Denis.
Nous souhaitions également vous faire connaître l'ouvrage de Pascal Le Rest, spécialiste reconnu de la prévention spécialisée, qui propose de revenir aux "fondamentaux" du métier, contre les injonctions sécuritaires qui érodent la teneur éducative. Vous pouvez découvrir un compte-rendu de lecture de cet ouvrage ci-dessous, qui résume le propos du livre.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous invitons à nous retrouver sur notre page Facebook,
Rézo Social 93

Compte-rendu :
Pascal Le Rest, 2019, Mais qui veut la mort de la prévention spécialisée ?, Paris, L’Harmattan, Coll. Educateurs et Préventions
Compte-rendu de lecture :
Pascal Le Rest est assez connu dans le monde de la prévention spécialisée : cet ancien éducateur spécialisé devenu docteur en ethnologie mène des recherches sur ce sujet depuis près d’une vingtaine d’années, a publié une multitude d’ouvrages sur ce type d'intervention socioéducative et sur les questions de jeunesse, et a exercé comme conseiller technique et chargé d’études dans des structures de prévention spécialisée.
Comme il l’explique dans la « mise au point » qui entame son dernier ouvrage, paru cet été, Le Rest pensait avoir « fait le tour de la question » (p. 9) mais l’actualité l’a rattrapé. L’actualité, c’est d’abord le terrorisme austéritaire qui a fait éclater les financements du secteur, engendrant d’innombrables suppressions de postes, dont celui de Pascal Le Rest lui-même, qui a perdu son emploi de conseiller technique à l’ADSEA77 au printemps 2016. L’actualité, c’est aussi et surtout l’injonction à intervenir dans les dispositifs sécuritaires et notamment dans la lutte anti-terroriste, qui se développe en direction de la prévention spécialisée. Le problème avec ces nouvelles injonctions sécuritaires, c’est tout d'abord l’instabilité et l’insuffisance du concept de « radicalisation », de même que l’usage aberrant du terme de « djihad » qui est fait ces dernières années, sans aucune analyse :
« Après les différents attentats qui ont marqué l’histoire récente de notre pays, à partir de 2012, il n’y a pas eu de prise de recul, de réflexions sur le choix des mots pour réagir à la violence ou à la barbarie. Nombreux ont été les acteurs, politiques et mêmes intellectuels, à reprendre les termes employés par les grands médias qui n’en possédaient pas la connaissance, comme djihad par exemple. Or, l’usage médiatique de certains termes pour combattre la violence peut avoir un effet inverse » (p. 15).
Le problème c'est également qu'intervenir auprès de populations ciblées en collaboration avec les organismes sécuritaires va à l'encontre des principes et de la philosophie qui font la spécificité de la prévention spécialisée :
« ce n’est plus le même métier. Si l’éducateur de rue ne peut pas établir une relation de confiance avec un jeune, alors il ne peut pas travailler dans un sens bénéfique au jeune [...] la prévention spécialisée n’a pas d’avenir si elle devient l’instrument du renseignement public pour le compte de la Sécurité intérieure. Le bras armé d’une politique du renseignement qui rappelle des heures bien sombres de notre histoire. Elle n’a peut-être pas non plus d’avenir si elle se positionne contre la lutte et la prévention de la radicalisation. Mais du moins a-t-elle le choix de sa mort ! » (p. 20-21).
C'est pourquoi l'objectif affiché de ce livre est de revenir aux "fondamentaux" du métier, à commencer par ses principes et son histoire.
La prévention spécialisée voit le jour après la Seconde guerre mondiale en s’appuyant sur « des manières nouvelles de s’y prendre avec la jeunesse (…) respectueuses du parcours, des situations et des problématiques » (p. 23). F. Deligny à Lille à partir de 1943 mène cette forme de prévention de façon innovante. On retrouve d’autres initiatives de ce type notamment en région parisienne.
Le secteur commence à s'institutionnaliser avec l'émergence du problème des « blousons noirs », qui affole la presse et les politiciens vers 1959 – 1962, et qui fait apparaître la prévention spécialisée comme une réponse adéquate. Après Mai-68, les éducateurs de rue sont repérés comme « très critiques par rapport à l’ordre bourgeois de l’époque (…) Ce contexte provoquera une distanciation voire une certaine méfiance des administrateurs, élus et financeurs (plutôt des notables) à l’égard des éducateurs, considérés comme des militants gauchistes » (p. 28-29). Cela n'empêche pas la prévention spécialisée de se développer énormément après l'arrêté de 1972.
En revanche, entre 1981 et 1983 s’opère un tournant vers des politiques d’insertion et de sécurité, accentué par la décentralisation à partir de 1986, phénomènes qui placent la prévention spécialisée dans un certain « inconfort » (p. 29-30). Le climat du secteur devient de plus en plus « morose », les professionnels sont « suspicieux » (p. 30). Il est donc nécessaire de retrouver le cœur du métier en plongeant dans « le quotidien », et dans la richesse des principes d'action spécifiques à ce secteur (p. 31).
- Une adhésion librement consentie par les adolescents et les jeunes majeurs, p. 41
Ce principe implique que le jeune doit manifester son « choix » et « signifier un désir d’aide », une sorte de « contre-don » à l’offre qui lui est faite. C’est « la compétence d’acteur » qui est sollicitée, la capacité à accepter ou refuser une offre relationnelle (p. 41-42). Ainsi, l’inscription de l’éducateur sur un territoire à travers le travail de rue est fondamentale, tout en faisant preuve d’empathie, de ruse, et d’observation « des signes et des symboles » qui font sens. C’est un « travail d’équilibriste » appuyé notamment sur la confiance (p. 42), et sur le « désir » du jeune, tout en respectant le postulat que le jeune est libre sur le territoire où il habite et rencontre l’éducateur.
- Le respect de la confidentialité, p. 44
L’éducateur doit faire preuve de « discrétion » et de « confidentialité » pour que le jeune se confie, dans le respect du secret professionnel, pour un créer un « cadre sécurisant » (p. 44). L’éducateur peut échanger des informations pour collaborer avec des partenaires mais avec l’accord du jeune et sans en dévoiler trop. Cependant dès 2004 et notamment avec la loi de prévention de la délinquance de 2007, cet anonymat est fortement remis en cause et les services sociaux sont appelés à collaborer avec la mairie (p. 45-47). Cela risque de dégrader la confiance et le traitement socioéducatif des problématiques des jeunes (p. 48).
- L’absence de mandat nominatif, p.48
Cette absence de mandat est une des spécificités de la prévention spécialisée. Il y a pourtant bien une « commande sociale » (p. 49), qui signifie que l’éducateur ne peut représenter les jeunes dans les institutions : c’est plutôt l’équipe qui est mandatée (p. 50). D’une certaine façon le Département contractualise avec l’association, qui contractualise avec l’éducateur (p. 51).
- La philosophie de l’action, p. 53
La prévention spécialisée est une démarche d’ « aide à la personne » pour que chacun trouve sa « place » dans la société (p. 53). Elle combat les « iniquités » mais connaît ses propres limites, ce qui peut donner à voir des « paradoxes ». Il faut donc un très fort « engagement » en tension avec tout un cadre professionnel. Il faut « apporter de la lumière », c’est-à-dire de « l’espoir » et transmettre une « croyance » en un avenir meilleur pour les personnes accompagnées, en la proximité sociale ou culturelle avec elles (p. 55).
- Des méthodologies éducatives éprouvées, p. 55
On peut comparer la nécessaire « immersion » durant le travail de rue à l’observation ethnologique, mais l’ethnologie contrairement à la prévention spécialisée ne cherche pas à changer son sujet d’étude (p. 56).
- Des territoires d’intervention variés, p. 56
Toutes les structures de prévention spécialisée sont différentes mais il y a des constantes (p. 58-59), même si les pratiques évoluent avec les nouveaux types de territoires et les nouvelles problématiques (p. 59). Il évoque le cas des « villes nouvelles » (p. 59-60) et des zones rurales (p. 60-61), avant de faire observer qu’il y a une inégale répartition géographique de la prévention spécialisée suivant une « logique historique » (p. 61), différents développements dans le temps, différents types de financements et de contractualisation (p. 62-63).
La prévention spécialisée compte différents types d’acteurs, de niveaux d’équipe et de réunions.
- Le directeur, garant de la mise en œuvre du projet associatif (p. 65) : responsabilisation et « interface ». Collusion avec les chefs de service. Recrutement, gestion financière, partenariats.
- Les relations entre administrateurs et salariés (p. 67) : dans les petites associations il y a davantage de proximité entre CA et salariés que dans les grandes associations, où la prévention peut ne pas être la seule activité. Il y a différentes réunions, assemblées générales, et une collusion entre président et directeur à différents niveaux.
- Les chefs de service éducatif (p. 69) : encadrement des équipes, membre de l’équipe de direction, « il doit faire vivre le sens de l’action » (p. 69), il pilote l’évaluation doit gérer le « paradoxe » entre travail de terrain et demandes institutionnelles de lisibilité (p. 69). Il doit également rester à distance égale des différents acteurs.
- Entre commande publique et projet associatif, l’autonomie des éducateurs et leurs limites (p. 70) : les éducateurs s’inscrivent dans un cadre professionnel et de politiques sociales, mais ont une certaine autonomie même s’ils doivent rendre des comptes (p. 70), produire des écrits, se référer à l’équipe et au territoire… Ne pas oublier qu’ils sont « salariés » et non « militants » ou « bénévoles » (p. 71).
- Le pôle technique (p. 72) : l’ensemble des salariés, dont ce pôle, concourt à la mission et au projet associatif. La secrétaire est au cœur du travail (p. 72-73). Il évoque les fonctions du comptable, du conseiller technique, des intervenants ponctuels… Le directeur doit harmoniser ces multiples interventions.
- Plusieurs types de réunions (p. 74) : réunions d’équipe hebdomadaires, l’analyse des pratiques (p. 74-75), différentes réunions selon le nombre de cadres et si la fonction de chacun est bien définie (p. 76), réunions institutionnelles, réunions thématiques.
Cadre législatif et réglementaire, p. 79
Le cadre législatif et réglementaire doit être étudié car il « permet de situer l’action de la prévention spécialisée dans le registre de l’action sociale, notamment en matière de protection de l’enfance, dont la compétence relève des départements » (p. 79).
- Les textes réglementaires législatifs de référence, p. 79
Il y a au moins deux textes qui balisent le cadre juridique de la prévention spécialisée avant 1972 : l’ordonnance du 23 décembre 1958 qui contient des mesures sur les enfants en danger, et l’arrêté du 13 mai 1963 qui crée le Comité National des clubs et équipes de prévention pour l’inadaptation de la jeunesse (p. 79). L’arrêté de 1972 et ses circulaires inscrivent les principes et méthodes de la prévention spécialisée dans la loi, d’où leur importance. Enfin, la loi du 30 juin 1975 inscrit la prévention spécialisée dans la protection de l’enfance. Viennent ensuite les différents textes sur la décentralisation (1982, 1983, 1986) (p. 80). Si la prévention spécialisée demeure une « compétence départementale méconnue », elle est réaffirmée dans le document de l’Assemblée des Départements de France de 2002.
- La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, p. 81
Cette loi réforme celle du 30 juin 1975. Elle veut rationaliser l’action sociale, au service des personnes accompagnées. Elle mentionne explicitement la prévention spécialisée (p. 81) et la conforte comme appartenant à l’Aide sociale à l’enfance. La situation du secteur se précise avec l’ordonnance 2005-1477 du 1er décembre 2005, qui précise le rapport au droit des usagers, à la tarification, à l’évaluation… (p. 83)
- Le cadre institutionnel, inscrit dans la protection de l’enfance, p. 83
Le rapport du
Groupe de travail interinstitutionnel sur la prévention spécialisée qui a rendu son rapport en 2004 montre que les auteurs, acteurs notables de la prévention spécialisée à l’époque, réaffirmaient le lien de la prévention spécialisée à l’Aide sociale à l’enfance, donc au Département, tout en conservant des enjeux de collaboration avec la commune. Il y a un «
niveau opérationnel » et un «
niveau politique et stratégique » (p. 86).
- La déontologie à l’épreuve de la loi de prévention de la délinquance, p. 87
Tout le cadre réglementaire décrit produit « de fait une déontologie professionnelle ». L’éducateur sans être en « alliance » avec les jeunes doit néanmoins défendre leurs droits (p. 87). Face à ce cadre déontologique, la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a « l’effet d’une bombe ». Cette loi bouleverse les équilibres institutionnels, enclenche une « confusion » entre difficultés sociales et délinquance, un « glissement » des termes… (p. 88). Le rôle du maire face aux associations de protection de l’enfance et face au Département exacerbe le « tiraillement ». L’Assemblée des Départements de France ne prend pas position et laisse « filer les problèmes » (p. 89).
Avec cette loi, les « enjeux politiques, circonstanciels, conjoncturels » ont pris le dessus sur les réels besoins sociaux (p. 91). Le « secret partagé » pose question aux professionnels et bouscule les pratiques (p. 92-93), cette loi pose des questions mais sans proposer aucune méthodologie. Les équipes doivent « bidouiller » (p. 94). Avec cette loi la « vision du monde » est différente : on passe de la protection de l’enfance à la protection de la société (p. 94).
Cette loi a réellement bouleversé tout le champs et enclenché le « grand bal » des déconventionnements, les élus étant depuis le 11 septembre 2001 plus sensibles au sécuritaire : « la prévention n’était plus un but en soi », même si elle est à contre-courant depuis les années 1980 (p. 95). Cela isole davantage les éducateurs dans la « défiance » à l’égard de leurs propres hiérarchies. Ils sont obligés de « tricher » pour continuer à « incarner auprès des jeunes des perspectives d’avenir » (p. 96).
Un travail d’équipe ancré sur un territoire, p. 97
Il y a toujours une « diversité » des profils dans les équipes de prévention, même s’il y a 50% de diplômés E.S. sur tout le territoire. Cette diversité est un « atout » (p. 97). Travailler en équipe prend différentes formes, mais est toujours fondamental car l’équipe a de nombreuses fonctions (p. 98-99), d’autant qu’il y a eu une forte professionnalisation (p. 100).
Les éducateurs travaillent sur des territoires qui peuvent être très variés, mais qui sont tous des « constructions mentales » pour les acteurs (p. 101), comme l’illustre l’exemple de territoires ruraux (p. 101-102). Les éducateurs doivent connaître et s’adapter aux « savoir-s’y-prendre », aux modes d’action et d’interaction locaux, ils doivent « partager une réalité commune », et valoriser les capacités de chacun pour produire le changement sur un territoire, « produire en permanence du sens », croire en l’ « intelligence du désordre » que peuvent avoir les habitants (p. 102-103).
Les éducateurs doivent gagner la confiance de jeunes parfois difficiles, éloignés et défiants envers les institutions, en prenant une apparence non-institutionnalisée (p. 104), mais les moyens et la volonté institutionnelle de combler ces distances sont insuffisantes (p. 106).
La prévention doit travailler avec une variété d’acteurs, selon différentes approches, et sur différents thèmes, et donc penser le passage de relai de certaines actions (p. 111-112). Il faut de la « transversalité » et du « partenariat » pour produire du changement sur un territoire : les outils de la prévention spécialisée seule ne suffisent pas (p. 112-113). Mais les partenariats existent, comme le montre l’exemple des chantiers éducatifs (p. 113).
Immersion de l’éducateur : le travail de rue, p. 115
Il faut « se faire voir » des habitants pour favoriser les « rencontres » (p. 115-116), mais aussi savoir mener un travail d’observation (p. 117). Le travail de rue se fait « en fonction d’une réalité de terrain » (p. 117). Partie intégrante de la « culture professionnelle », il vise à favoriser le « lien social » (p. 118).
Accueillir dans un local et rencontrer dans la rue n’impliquent pas les mêmes postures (p. 119-120). Il faut développer une réelle « immersion » pour envisager de développer des actions. Il faut alterner entre « observation » et « intervention » (p. 121). Vu de l’extérieur, le travail de rue peut avoir l’air passif, mais c’est qu’il faut le temps de « l’imprégnation » (p. 122).
Le travail de rue a différents temps et horaires (scolaires et autres…) selon les différents objectifs : il se fait dans des « milieux de vie » (p. 122-123) ; en période sécuritaire le bien aux habitants peut donc être plus délicat à entretenir (p. 124), comme l’ont montré les révoltes populaires de 2005 (p. 125).
Relation éducative individualisée, p. 133
« L’éducateur travaille l’accompagnement éducatif à partir des contacts qui ont pu se produire par le travail de rue » (p. 133). Cette relation suppose donc une « confiance » qui ne peut advenir quand l’éducateur est mandaté par les dispositifs sécuritaires (p. 133)
La parole et l’écoute sont fondamentaux pour travailler la demande et la recherche de solutions qui fondent l’accompagnement (p. 133-134). Il faut que l’éducateur manifeste son « désir » et sa « volonté » de soutenir l’Autre : c’est le « transfert positif » (p. 135).
La relation étant asymétrique, l’éducateur doit veiller à ne pas faire à la place de l’autre. Par ailleurs les différentes définitions de l’accompagnement s’accordent sur le fait qu’il doit s’enraciner dans une rencontre libre (p. 135), dans la « souplesse et l’adaptation » des professionnels, qui leur confèrent une « latitude » productrice de confiance.
L’accompagnement par ailleurs ne s’appuie pas que sur de la déontologie mais aussi sur de la méthodologie, notamment celle de l’entretien qui permet de donner à voir aux personnes accompagnées les « qualités » de l’éducateur (p. 136). L’accompagnement, visant à produire un « projet de vie » qui vienne du jeune lui-même, ne peut se réduire à des « actes professionnels codifiés » (p. 136).
Chaque « projet de vie » et les démarches qui vont avec son spécifiques : il ne faut cependant pas se précipiter lorsqu’il y a une demande initiale. Il faut prendre le temps de faire connaissance mutuellement (p. 137-138). Viennent ensuite des entretiens plus « élaborés » où on explore les problématiques, où on explore les problématiques, et où l’éducateur peut signifier sa présence ou « lâcher prise » (p. 138). L’accompagnement varie selon les classes d’âge. Il doit pouvoir être évalué par le bénéficiaire (p. 140).
Relation aux groupes d’adolescents et de jeunes majeurs, p. 145
Le groupe est «
un ensemble de personnes aux caractéristiques identifiables qui produisent des pratiques communes ». Il en existe de différents types (p. 145). Généralement les groupes préexistent à la relation éducative, mais l’éducateur peut aussi constituer des groupes, étant dans tous les cas «
déclencheur dans la dynamique de groupe » (p. 145-146).
Il y a cependant une difficulté à penser le groupe en lui-même, et autrement que comme une somme d’individus à accompagner séparément, à terme. Les éducateurs s’efforcent alors de faire des «
ponts » entre le groupe et l’individu (p. 147-148). Il existe néanmoins des outils (séjours, chantiers), pour travailler sur le groupe, le lien social, la sociabilité – tandis qu’à l’individuel on travaille davantage le «
projet de vie » (p. 149-150). Dans les deux cas l’éducateur travaille à «
l’autonomisation » (p. 151). Il y a une «
querelle classique » entre ceux qui estiment qu’il faut privilégier l’individuel et ceux qui sont plus collectif, car les moyens et le temps sont limités : les associations doivent prendre position pour structurer une organisation du travail, il appartient «
aux directions des associations de déterminer l’ordre des enjeux » (p. 152).
Les éducateurs utilisent les techniques ou supports pour «
créer une dynamique de socialisation » (p. 155). Ils doivent «
arpenter les territoires » et diagnostiquer les «
intentions » et capacités des gens avant de proposer un projet (p. 156), en gardant à l’esprit «
qu’un projet n’est qu’un prétexte dans une intention plus ambitieuse, qui consiste à favoriser le fait que chaque jeune puisse construire sa place dans l’espace sociétal » (p. 157). Les groupes sont en effet un levier pour «
transformer à partir de ressources invisibles mais potentielles des réalités pénibles » (p. 158).
- Les risques d’un glissement vers l’individualisation, p. 163
Il y a un glissement vers des approches individualistes et culpabilisantes dans tout le travail social. La prévention spécialisée n’y échappe pas, à cause du management, qui mute vers un
taylorisme et une méconnaissance des principes historiques (p. 163-164). Le travail social collectif peut pourtant représenter un renouveau, comme estimait l’IGAS dans un rapport de 2005 (p. 165-166).
De l’élaboration du partenariat aux actions de terrain, p. 167
Le partenariat, « fondement » de la prévention spécialisée, permet des « expérimentations » intéressantes (p. 167), comme le montre l’exemple de projets à l’intérieur des collèges ou lycées. Les actions peuvent être diverses. Leur « évaluation » permet de recalibrer des axes de travail (p. 170-171). Elles peuvent contribuer au « développement social local », à condition de prendre le temps de construire une « proximité » entre les différents acteurs (p. 172-173).
Il faut une réelle volonté institutionnelle pour pérenniser ce type d’actions ce qui pose la question de la non-institutionnalisation de la prévention spécialisée. Le secteur en lui-même est institutionnalisé, mais ce sont surtout ses « actions » qui ne doivent pas l’être : la prévention spécialisée doivent construire des passages de relais (p. 175).
Il faut des « formalisations institutionnelles » (comme des signatures de protocole) pour clarifier les rôles et principes de chaque partie prenante au partenariat (p. 176), cependant « le pilotage du dispositif est évidemment le point nodal » (p. 177), il faut une « coordination » et une définition des termes du protocole autant qu’une disponibilité et une volonté des professionnels pour faire vivre ce protocole (p. 178-179).
Les réunions partenariales peuvent être chronophages et porter des enjeux diplomatiques : les associations et notamment les directions doivent y réfléchir, notamment avec l’invasion sécuritaire qui éloigne des réalités de terrain autant que des principes éthiques (p. 180-181). Avec la loi de prévention de la délinquance de 2007 qui met en place de fait un « secret partagé » (p. 181) les directions doivent se positionner pour sécuriser le travail éducatif, auquel cas la confiance et le travail de rue continueront à reculer (p. 182)
Les acteurs de terrain sont généralement convaincus de l’importance des partenariats mais les difficultés et carences de « pilotage » peuvent les freiner considérablement. En l’absence d’une saine « formalisation institutionnelle », chacun peut amener sa réponse personnelle, ce qui génère des incohérences voire des tensions (p. 183). Il faut pour pallier ces risques donner la parole à tous les partenaires (p. 184) mais surtout au public : c’est ce dernier qui « fonde la légitimité de l’action partenariale » (p. 184). Après avoir évoqué différentes plus-values des chantiers éducatifs (p. 185) l’auteur note que l’éducateur doit être « l’interface » entre différents acteurs, il doit « huiler les relations » (p. 186).
Traduction de l’intervention et communication : la question de l'évaluation, p. 187
Depuis 2005 la prévention spécialisée est dans le champ de la loi 2002-2, mais l’évaluation ne se limite pas aux obligations légales. La « complexité doit être traduite » et nombre d’acteurs sont en attente de « compréhension » de l’action (p. 188).
« La démarche d’évaluation ne peut être dissociée de la question du sens et des valeurs de la prévention spécialisée » (p. 188). Les indicateurs sur les quartiers sont inquiétants, il y a des tensions entre éducateurs, cadres et élus, face à quoi il faut « travailler sur les décalages » et élaborer un discours associatif « cohérent ». Avec beaucoup de « fantasmes », les élus adressent des demandes irrecevables à la prévention spécialisée. Cette dernière accompagne dans une globalité des individus susceptibles de passer à l’acte, elle ne travaille pas sur une ou des thématiques spécifiques : les directions doivent faire entendre cela impérativement (p. 189).
Beaucoup d’acteurs promeuvent innocemment l’évaluation alors qu’elle n’est qu’un processus de contrôle, ou en tout cas, elle ne sert actuellement qu’à ça (p. 190). Il y a un enjeu à « investir l’évaluation » dans « une volonté explicative » pour recouvrer des moyens de parler du travail (p. 191).
Depuis la décentralisation, la prévention spécialisée est englobée dans une action sociale plus globale, et il y a donc un « flottement » sur sa place et ses enjeux, jusqu’au milieu des années 2000. Nombre d’acteurs ont des « attentes démesurées » à l’égard des éducateurs, qui ont pu accepter, depuis 2005 et les attentats, des demandes intenables (p. 192-193).
L’évaluation reste difficile mais les associations y réfléchissent, volontairement. Dans ces dynamiques les directions doivent être garantes d’un projet de service porteur de valeurs, car ce qui doit demeurer fondamental dans l’évaluation de la prévention c’est son « échelle de valeurs » (p. 194)
Conclusion, p. 195
Les principes progressistes de la prévention spécialisée, notamment issus de Mai-68, ont traversé le temps, les crises, et construit une professionnalité toujours en vigueur (p. 195). La fin des Trente Glorieuses puis notamment les attentats à partir de 2001 ont ouvert la voie à l’ultra-sécuritaire, à contre-courant duquel se situe la prévention spécialisée. La loi de prévention de la délinquance de 2007 a été un « virage à 90 degrés » qui a produit de la suspicion de la part de la prévention spécialisée face au contexte libéral-sécuritaire, et vice versa (p. 196). La prévention spécialisée est dans une « zone de turbulence » depuis au moins la décentralisation, et reste une « variable d’ajustement » budgétaire. Les récentes tentatives d’ « instrumentalisations » montrent en revanche qu’elle est un outil riche et qui « séduit » les communes. Seulement, avec la lutte anti-terroriste et contre la radicalisation la prévention spécialisée est prise dans un tourbillon ces dernières années (p. 197). Elle reste malgré tout une méthode d’intervention originale et a priori pertinente pour beaucoup de gens qui n’ont pas d’autres solutions.
Le souci qui se pose est celui de la formation aux méthodologies : les professionnels ne sont généralement pas formés en centre de formation et les cadres doivent assurer une transmission de savoir-faire dans les associations, pour ne pas qu’elles deviennent des services d’accompagnements individualisés en milieu ouvert. Ils doivent également communiquer à propos de ces principes et méthodes avec les élus, car sans ces principes et la « philosophie de son intervention » la prévention spécialisée n’est plus (p. 198)